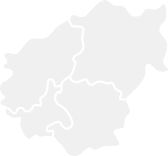Mardi saint 27 mars 2018 - Messe chrismale
Frères et sœurs,
La messe chrismale tire son nom de l’huile parfumée qu’on appelle le chrême, qui, au cours de cette messe, est consacré par
l’évêque, en présence des prêtres concélébrants, car ils sont les coopérateurs de leur évêque dans la confection du chrême, eux
qui partagent sa mission sacrée d’édifier le peuple de Dieu, de le sanctifier et de le guider.
Cette huile parfumée, le saint-chrême, emprunte elle-même sont nom à celui de Jésus, appelé Christ, c’est-à-dire en grec celui qui a reçu l’onction de l’Esprit Saint, lorsqu’il descendit dans les eaux du Jourdain pour y recevoir le baptême donné par Jean.
Messe chrismale, saint-chrême, Christ : c’est la même racine qui renvoie à l’onction céleste, la puissance de la grâce divine qui,
par le Christ, Fils de Dieu,opère en nous le salut. Voilà pourquoi la prière de consécration du saint- chrême, que je prononcerai
tout à l’heure, parle du « chrême du salut » qui nous fait « participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel ».
La prophétie d’Isaïe, dont Jésus fait la lecture publique lors de l’Office liturgique dans la Synagogue de Nazareth, au
commencement de sa vie publique – « l’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction » -
cette prophétie, il se l’applique à lui-même : « aujourd’hui, s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre ».
C’est lui le Messie, le Christ, tant attendu, que les prophètes avaient chanté ; c’est lui l’Oint du Seigneur ; c’est lui le Verbe éternel
du Père qui a pris chair dans notre chair, c’est lui le Sauveur des hommes. Cette même prophétie d’Isaïe, elle s’applique
également à nous tous, depuis le jour de notre baptême, où nos fronts ont été marqués par le saint-chrême, l’huile
du salut, et où nous sommes devenus, comme aimaient à le dire les Pères de l’Eglise, d’ « autres christs », parce que, comme lui
, nous avons reçu l’onction de l’Esprit-Saint, pour être rendus participants de la vie divine, dans l’Eglise Corps du Christ
et Temple de l’Esprit. Le saint-chrême sur nos fronts de baptisés et de confirmés est le signe de notre consécration, de notre
configuration au Christ, comme prêtres, comme prophètes et comme rois. Prêtres, nous le sommes tous devenus, pour offrir
notre vie à Dieu dans l’offrande du Christ (le sommet de cela, c’est la messe) ; prophètes, nous le sommes devenus pour porter
à nos frères et sœurs en humanité la Bonne Nouvelle du salut ; rois, nous le sommes devenus pour servir nos frères et
sœurs dans la charité.
Au service de cette triple mission baptismale, dans l’Eglise et pour le monde, le Seigneur choisit des hommes, pris parmi le peuple
des baptisés, mis à part sans être séparés. Ce sont les évêques et les prêtres, chargés d’enseigner, de sanctifier et de guider
le peuple des baptisés. Par l’onction de l’Esprit Saint, reçue lors de leur ordination sacerdotale, les prêtres ont vu leurs mains
marquées par le saint-chrême pour que ces mains bénissent et consacrent, pour qu’ils sanctifient le peuple de Dieu et
qu’ils offrent à Dieu lesacrifice eucharistique. Par l’onction du SaintEsprit, lui conférant la plénitude du sacerdoce apostolique,
l’évêque,au jour de sa consécration, a reçu sur sa tête le signe du saint-chrême pour que son ministère apostolique soit rendu
efficace par la bénédiction de l’Esprit-Saint.
Je n’ai pas oublié les diacres ! Eux, n’ont pas reçu, au jour de leur ordination, le signe du saint-chrême, parce que leur ministère
n’a pas pour but de consacrer l’offrande eucharistique ; mais ils ont été, comme l’évêque et les prêtres, consacrés par l’onction de
l’Esprit-Saint. L’évêque leur a imposé les mains, afin que, par leur ministère, ils aident l’évêque et les prêtres dans la triple
diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité. Avec l’évêque et les prêtres, ils sont les signes du Christ, « venu non pour
être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude ».
Frères et sœurs, le saint-chrême est le signe du salut, le signe que nous avons tous part, quel que soit notre état de vie – laïc,
diacre, prêtre, évêque, religieux, religieuses – au mystère du Christ, au mystère pascal du Christ. Ce mystère pascal, c’est-à-dire
sa mort et sa résurrection, nous allons le célébrer solennellement dans le Triduum pascal qui commencera avec la célébration de la
Cène du Seigneur, le jeudi saint au soir. Mais, nous le célébrons aussi à chaque eucharistie et dans les autres sacrements. Le saint-chrême est le signe de notre commune dignité de baptisés, de fils et filles de Dieu, de membres de l’Eglise, Corps du Christ.
Cette Eglise, une, sainte, catholique et apostolique – comme nous le disons dans le Credo –, elle s’incarne dans le diocèse qui est
une portion du Peuple de Dieu. Et la messe chrismale, dans la cathédrale, Eglise-mère du diocèse, avec l’évêque, les prêtres,
les diacres, les laïcs et les consacrés, en est une des plus belles manifestations. Elle me donne l’occasion, aujourd’hui, de revenir
sur l’esprit et la lettre des Orientations pastorales diocésaines que j’ai promulguées il y a deux ans et demi, en cette même
cathédrale.
Nous avons travaillé à leur mise en œuvre, mais le chemin n’est pas fini. Le Jubilé des 700 ans du diocèse, coïncidant avec ces
Orientations diocésaines, devrait nous permettre d’en approfondir davantage les trois axes : pour une Eglise fraternelle,
missionnaire et appelante.
Ces Orientations pastorales ne sont pas une réforme structurelle ou administrative des paroisses. L’esprit qui les anime est celui qui
a présidé à la rédaction par le pape François de l’Exhortation apostolique post-synodale « La joie de l’Evangile ». Il s’agit de rendre
notre diocèse, ses diverses communautés paroissiales – « les Communautés locales » - davantage missionnaires. Cela passe par
une synergie autour de trois éléments principaux : les fraternités de prêtres, les Communautés locales avec chacune leur Equipe
d’Animation pastorale et des fraternités locales missionnaires.
Il s’agit de faire en sorte que les prêtres, réunis dans 4 fraternités presbytérales, portant ensemble la mission, puissent s’appuyer
sur une Equipe d’Animation pastorale, dans chacune des Communautés Locales. Une Communauté locale, c’est un groupement
paroissial autour d’un bourg principal où existe une réalité humaine, économique et sociale, suffisamment étoffée et surtout un
nombre de chrétiens suffisants pour vivre ensemble les trois modalités de la vie baptismale : l’annonce de l’Evangile, la
célébration des sacrements et le service organisé de la charité fraternelle. En même temps, pour que dans les villages, les clochers,
et même dans les paroisses urbaines, chaque baptisé ne reste pas isolé, mais puisse vivre en disciple-missionnaire, il est
bon que se forment de petites fraternités locales missionnaires. Ce sont quelques personnes qui se retrouvent régulièrement,
en semaine, pour prier à l’église du village ou dans une maison, de manière toute simple, pour lire la Parole de Dieu et pour
vivre une dimension très importante
: le souci, dans leur voisinage, des plus fragiles, des isolés, des malades, des personnes âgées, pour les visiter et être
attentifs à leur besoin. Voilà en résumé les trois piliers des Orientations : fraternités presbytérales, Communautés locales avec
leur Equipe d’animation pastorale et fraternités locales missionnaires.
L’esprit des Orientations n’est pas celui de la centralisation dans la ville principale de chacun des 4 Espaces missionnaires : Tulle,
Brive, Objat et Ussel, là où se trouvent les fraternités de prêtres. Non, ce n’est pas cela. Si les prêtres sont appelés à constituer
4 fraternités presbytérales, dans ces 4 villes, c’est pour qu’ils ne soient pas isolés, mais portent ensemble la charge pastorale. Cela,
dans une vie fraternelle, une table commune pour le repas de midi, un temps quotidien de prière ensemble et un temps de travail
ensemble dans une réunion hebdomadaire. C’est en fait ce que préconisait déjà le Concile Vatican II. Ces quatre fraternités n’ont donc
pas pour but de conduire à une centralisation de la vie pastorale dans les 4 villes de leur résidence. S’ils partagent une vie
fraternelle, ce n’est pas pour former une Communauté à la manière des religieux, mais pour se soutenir dans leur ministère qui
consiste à aller vers chacune des Communauté locales dans un Espace missionnaire. Ces Communautés locales ne sont pas
« rattachées » à un centre (Tulle, Brive, Objat ou Ussel), mais elles doivent se prendre en charge, chacune, avec un des prêtres de
la fraternité qui est davantage responsable de telle communauté locale, avec son Equipe d’animation pastorale.
Les Orientations pastorales diocésaines veulent éviter deux dangers qui sont mortifères pour les diocèses ruraux comme le nôtre.
- Le premier est celui de la dispersion du clergé, où chaque prêtre est tout seul responsable, comme il veut et comme il peut, d’un
groupement paroissial, au risque de s’épuiser, de tomber dans la routine et de n’avoir aucun lieu de ressourcement et de vie
fraternelle avec d’autres prêtres, en mangeant seul, en priant seul, en organisant seul la vie pastorale. Ce type de vie
et de ministère, ce modèle de vie sacerdotale est une des causes de l’absence de vocations dans les diocèses ruraux.
Ce n’est pas la seule, mais c’est une des causes.
- Le deuxième danger est la centralisation, parce qu’on n’arrive plus à tenir le maillage territorial paroissial, tel qu’il a été conçu depuis
le Moyen-Âge : un clocher, une paroisse, un curé. Alors, on regroupe, on regroupe, on regroupe, jusqu’au jour où la vie ecclésiale
disparaît, non seulement dans les petits clochers, mais même dans les bourgs, pour finalement se concentrer dans quelques villes.
Ce n’est d’ailleurs pas que le problème de l’Eglise, mais celui de la gestion civile de l’espace rural dans la majorité des départements
français. On peut même dire que c’est un phénomène mondial. Il faut essayer d’enrayer cette logique mortifère.
Voilà pourquoi les Orientations diocésaines accordent l’importance la plus grande, ni aux petits clochers, aux petites paroisses
d’autrefois (qui n’ont pas été supprimées canoniquement, mais qui ne peuvent plus être des lieux de la vie en Eglise de manière
ordinaire), ni, à l’inverse, aux Espaces missionnaires avec leur 4 villes. Aucune de ces deux dimensions (micro ou macro dimension)
ne permet une vie ecclésiale digne de ce nom. L’importance doit aller aux Communautés locales, c’est-à-dire plusieurs paroisses
qui forment ensemble une sorte d’unité pastorale de base, dans laquelle une Equipe d’animation pastorale, constituée de 3 à 5
membres (pas plus), avec un des prêtres de la fraternité presbytérale qui la réunit régulièrement, doit penser et animer la vie
ecclésiale en ce lieu. Cette Equipe n’est pas chargée de tout faire, mais de veiller à ce que tout se fasse, tout ce qui est nécessaire
à une vie communautaire authentique.
Tout cela constitue un chantier en cours. Il faut avancer, sans doute sans se précipiter, mais résolument. Les fraternités presbytérales
se constituent progressivement. L’année pastorale prochaine, chacune de ces fraternités aura un nouveau curé modérateur, sauf
celle de Brive, puisqu’il vient d’arriver cette année et j’espère bien qu’il ne va pas changer trop vite ! Je remercie les prêtres qui
acceptent de porter cette charge et leurs confrères qui formeront avec eux la fraternité. Avec mon conseil épiscopal, je suis en train
de préparer ces nominations, en rencontrant les prêtres. Merci de les soutenir de votre prière pour qu’ils vivent ces changements
dans un esprit de foi et d’obéissance, et dans la plus grande paix possible.
Je sais bien que des chrétiens se plaignent et me disent parfois : nous n’avons plus de curé ! Aucune communauté ne doit se sentir
abandonnée. Même s’il n’y a plus un prêtre résident, il y a un ou plusieurs prêtres qui rejoignent ces Communautés.
Nous devrions penser un peu plus souvent à de très nombreux diocèses de par le monde, où des prêtres font de très longs trajets
pour rejoindre une Communauté, seulement quelques fois dans l’année. Ce n’est pas le cas chez nous. Mais cela ne veut pas dire
non plus qu’un prêtre doive passer sa vie sur les routes ! Dans chaque communauté locale, il faut s’organiser – y compris pour
la célébration des obsèques – sans que le prêtre soit tout le temps là. Et c’est d’ailleurs ce qui se passe dans plusieurs
communautés, où des laïcs sont engagés pour divers services et je les remercie. Le prêtre ne peut pas et ne doit pas tout faire !
Mais, avec l’Equipe d’animation pastorale, il doit veiller à ce que tout soit fait pour que l’Eglise se construise ici et maintenant.
Il doit pouvoir consacrer du temps à l’accueil et l’accompagnement personnel de celui ou celle qui demande un sacrement
(baptême, confirmation, réconciliation, mariage, onction des malades), particulièrement avec les catéchumènes, sans oublier
d’aller le plus possible au devant de ceux qui ne demandent rien et qui sont aux marges de la communauté. C’est dire que leur
tâche est lourde. « Le prêtre est un homme mangé », disait le Père Chevrier. Veillons tout de même à ce qu’il ne soit pas dévoré !
Je voudrais dire un merci spécial aux prêtres qui ont atteint l’âge de 75 ans, qui ont renoncé à leur charge curiale, comme le
demande le droit de l’Eglise, mais qui acceptent d’être prêtre auxiliaire et collaborent avec leur frères curés des fraternités
presbytérales. Leur ministère est très précieux, mais ils ont droit à être ménagés. Merci aussi aux prêtres qui sont « retirés »
comme on dit, à cause de l’âge, mais qui restent prêtres et qui rendent, ponctuellement, des services, si leur santé le permet.
N’oublions pas de les visiter et de prier pour eux. Ils prient pour nous.
Frères et sœurs, pardonnez-moi d’avoir été un peu long, mais je tenais à dire tout cela, puisqu’il y a ici les prêtres, les diacres,
et un bon nombre de membres des Equipes d’animation pastorale et divers acteurs de la vie ecclésiale dans les Communautés.
Comme le répète souvent le pape, ne nous lamentons pas, mais que chacun prenne sa part de travail dans la Vigne du Seigneur.
Et, ayons le souci permanent d’appeler, d’appeler, d’appeler de nouvelles personnes pour renouveler les équipes et que chacun
accepte de laisser sa place. J’ai donné comme repère 6 ans à un même poste. Ca ne veut pas dire qu’on ne peut pas faire autre
chose après. Nul n’est indispensable pour telle tâche particulière, mais on a besoin de tous dans l’Eglise. Que la Vierge Marie,
Mère de l’Eglise, humble servante du Seigneur, soit notre modèle et notre réconfort.
+ Francis BESTION
Evêque de Tulle